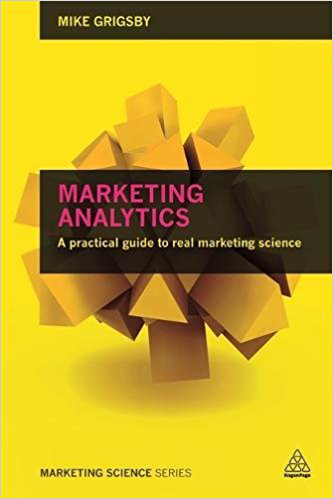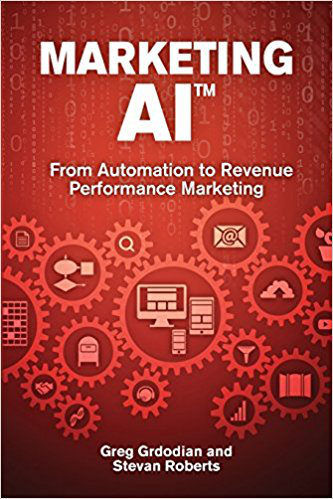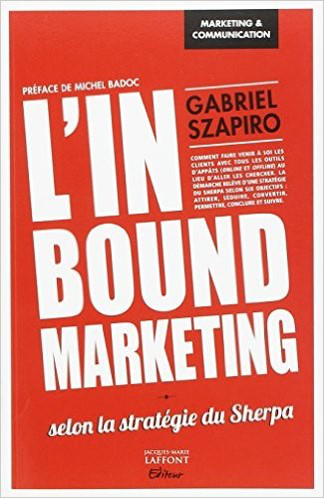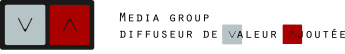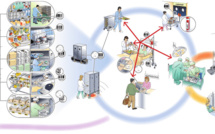Au delà de l'inquiétude générée par les attentats qui ont touché la France, quelles sont selon vous les causes du sentiment d'angoisse qui se répand au sein de la société ?
Nous redoutons le monde qui vient en regrettant le monde qui meurt ! Mais qu’en est-il vraiment ? Vivons-nous dans un monde véritablement plus dangereux qu’il ne l’a jamais été ? Le paradoxe de Tocqueville, sorte de constante sociologique, veut que plus un phénomène diminue, plus ce qu’il en reste semble intolérable aux yeux de la société et des individus qui la composent. La chose semble paradoxale mais elle est au final très compréhensible. En particulier lorsqu’il s’agit de la violence, de l’insécurité.
Nous vivons, en Europe, dans des sociétés qui ont très largement fait reculer la violence depuis plusieurs siècles. Ce fut un incroyable défi et une belle réussite, hélas pulvérisée par la première moitié du XXe siècle, mais reconstruite avec patience dès les années 50 et tout au long des Trente Glorieuses.
Il apparaît donc naturel que nos contemporains tolèrent chaque jour un peu plus mal la violence résiduelle, mais persistante et insidieuse – souvent concentrée dans des abcès en archipel –, qui travaille de l’intérieur notre collectivité, laquelle menace de devenir chaque jour aux yeux de tous une société de méfiance de chacun à l’égard de tous. Précisons de surcroît que si le crime de sang régresse, les nuisances au quotidien (notamment ce que l’on nomme pudiquement les incivilités) croissent et n’entrent guère dans les statistiques. Le « sentiment » d’insécurité apparaît par conséquent d’autant plus naturel que la violence actuelle se fabrique dans notre aveuglement stratégique et dans les abandons de la République, et qu’elle paraît donc scandaleuse au regard des progrès immenses accomplis tout au long de l’histoire européenne. On y décèle un fatalisme, une espèce de maladie de la volonté collective qui nuit à la crédibilité de l’Etat et accrédite l’idée d’un « ensauvagement » (comme l’écrit Thérèse Delpech), d’une barbarisation des rapports sociaux.
Voir ce que nous voyons, nommer ce que nous regardons : c’est bien là notre faille ! Nous ne savons pas ou ne voulons pas anticiper, lire les signaux faibles et sortir de la crise de la pensée stratégique (qui est aussi, mécaniquement, une crise de la réflexion sur l’insécurité). Pas davantage que nous ne nous donnons ensuite de vrais moyens d’agir. Le monde n’est pas pire qu’hier : il est en revanche clairement différent. C’est-à-dire que les dangers qui pèsent sur nos têtes ont muté. Or, nous ne savons pas lire ces changements et nous y adapter ! Certes, l’incertitude est une composante essentielle de l’univers contemporain, mais nous sommes plus souvent victimes d’aveuglement volontaire que de surprise stratégique. Le terrorisme focalise l’ensemble de ces évolutions. Mais fondamentalement, le sentiment d’angoisse collectif naît du fait que nous n’avons pas les moyens intellectuels pour comprendre les menaces.
Nous vivons, en Europe, dans des sociétés qui ont très largement fait reculer la violence depuis plusieurs siècles. Ce fut un incroyable défi et une belle réussite, hélas pulvérisée par la première moitié du XXe siècle, mais reconstruite avec patience dès les années 50 et tout au long des Trente Glorieuses.
Il apparaît donc naturel que nos contemporains tolèrent chaque jour un peu plus mal la violence résiduelle, mais persistante et insidieuse – souvent concentrée dans des abcès en archipel –, qui travaille de l’intérieur notre collectivité, laquelle menace de devenir chaque jour aux yeux de tous une société de méfiance de chacun à l’égard de tous. Précisons de surcroît que si le crime de sang régresse, les nuisances au quotidien (notamment ce que l’on nomme pudiquement les incivilités) croissent et n’entrent guère dans les statistiques. Le « sentiment » d’insécurité apparaît par conséquent d’autant plus naturel que la violence actuelle se fabrique dans notre aveuglement stratégique et dans les abandons de la République, et qu’elle paraît donc scandaleuse au regard des progrès immenses accomplis tout au long de l’histoire européenne. On y décèle un fatalisme, une espèce de maladie de la volonté collective qui nuit à la crédibilité de l’Etat et accrédite l’idée d’un « ensauvagement » (comme l’écrit Thérèse Delpech), d’une barbarisation des rapports sociaux.
Voir ce que nous voyons, nommer ce que nous regardons : c’est bien là notre faille ! Nous ne savons pas ou ne voulons pas anticiper, lire les signaux faibles et sortir de la crise de la pensée stratégique (qui est aussi, mécaniquement, une crise de la réflexion sur l’insécurité). Pas davantage que nous ne nous donnons ensuite de vrais moyens d’agir. Le monde n’est pas pire qu’hier : il est en revanche clairement différent. C’est-à-dire que les dangers qui pèsent sur nos têtes ont muté. Or, nous ne savons pas lire ces changements et nous y adapter ! Certes, l’incertitude est une composante essentielle de l’univers contemporain, mais nous sommes plus souvent victimes d’aveuglement volontaire que de surprise stratégique. Le terrorisme focalise l’ensemble de ces évolutions. Mais fondamentalement, le sentiment d’angoisse collectif naît du fait que nous n’avons pas les moyens intellectuels pour comprendre les menaces.
Quel rôle jouent les médias dans le phénomène du spectacle de la peur que vous décrivez?
On en connaît les mécanismes. D’abord un déluge informationnel permanent qui se focalise sur l’événement au détriment de l’analyse. De ce fait la recherche absolue du scoop abolit toute mise en perspective. Ensuite, l’uniformité de l’infotainment puisque le monde des journalistes est un milieu fermé et que le risque de conformisme s’avère donc immense. Enfin, sur le dogme du quatrième pouvoir se renforce systématiquement une véritable « idéologie journalistique » qui rend toute critique extérieure difficile concernant la qualité de processus de fabrication de l’information, ainsi que l’explique désormais régulièrement le Comité Orwell et sa présidente, Natacha Polony. Conséquence ? Il y a désormais peu d’espace pour le journalisme d’explication, au profit d’un véritable « journalisme d’inquisition » (mimant à la fois la posture du juge et de l’intellectuel).
Tout cela est malheureusement devenu un spectacle… Cette inquisition n’est pas tout à fait sérieuse : elle vise à créer le show, à entretenir l’audimat, c’est-à-dire le business… C’est la même dynamique qu’illustre la disparition de la hiérarchie de l’information, de l’égalisation de tous les événements et de tous les genres. Une seule catégorie existe en réalité : l’infotainment… De ce fait, dans l’insécurité, seul le criminel compte parce qu’il est hélas le « héros », le personnage principal, dont les médias retiennent le nom, le confiant à l’Histoire, au détriment des victimes, dont bientôt chacun oubliera l’identité. Le magazine Rolling Stone l’illustra hélas à la perfection en réservant sa couverture d’août 2013 au terroriste de Boston Dzhokhar Tsarnaev… On éprouve une certaine sensation d’irréalité en le voyant assimilé à une sorte de rocker désinvolte.
Rappelons nous de ce 18 février 1976 où Roger Gicquel lançait en ouverture du journal télévisé son fameux : « La France a peur »… A Troyes, un enfant, le petit Philippe Bertrand, avait été enlevé puis tué par Patrick Henry, qualifié alors – pour reprendre les mots exacts de l’époque – de malade mental. Le présentateur vedette mettait cependant en garde contre l’envie de vengeance expéditive. Sans doute sans le vouloir, il venait toutefois de marquer symboliquement l’entrée dans l’ère du show sécuritaire. Du journal de 20 heures à la diffusion via les canaux médiatiques des légendes urbaines (des histoires fausses a priori vraisemblables et possédant des variantes), il ne s’agit désormais que d’assurer le bon fonctionnement du théâtre de l’angoisse qui fascine les spectateurs. La télévision et l’Internet ne sont plus la forme moderne de l’œil divin mais les instruments de l’observation de tous par tous : en témoignent les émissions d’exposition de la vie privée (Cf. Loft puis Secret Story)
Par conséquent, l’information dite sérieuse utilise aujourd’hui les mêmes recettes de transformation de faits en légendes, à savoir l’amplification, le déplacement et la reconstruction. Légendes qui alimentent par la suite de nombreuses paniques (alimentaires, technologiques, etc.). Que penser au bout du compte ?… Faisons l’hypothèse que l’insécurité ne se confond pas avec le spectacle de l’insécurité… La première est une question liée à l’extension de la société de défiance, la seconde, un show business… Ce qui est certain, c’est que le spectacle de la peur contemporain altère considérablement les faits et biaise l’analyse.
Tout cela est malheureusement devenu un spectacle… Cette inquisition n’est pas tout à fait sérieuse : elle vise à créer le show, à entretenir l’audimat, c’est-à-dire le business… C’est la même dynamique qu’illustre la disparition de la hiérarchie de l’information, de l’égalisation de tous les événements et de tous les genres. Une seule catégorie existe en réalité : l’infotainment… De ce fait, dans l’insécurité, seul le criminel compte parce qu’il est hélas le « héros », le personnage principal, dont les médias retiennent le nom, le confiant à l’Histoire, au détriment des victimes, dont bientôt chacun oubliera l’identité. Le magazine Rolling Stone l’illustra hélas à la perfection en réservant sa couverture d’août 2013 au terroriste de Boston Dzhokhar Tsarnaev… On éprouve une certaine sensation d’irréalité en le voyant assimilé à une sorte de rocker désinvolte.
Rappelons nous de ce 18 février 1976 où Roger Gicquel lançait en ouverture du journal télévisé son fameux : « La France a peur »… A Troyes, un enfant, le petit Philippe Bertrand, avait été enlevé puis tué par Patrick Henry, qualifié alors – pour reprendre les mots exacts de l’époque – de malade mental. Le présentateur vedette mettait cependant en garde contre l’envie de vengeance expéditive. Sans doute sans le vouloir, il venait toutefois de marquer symboliquement l’entrée dans l’ère du show sécuritaire. Du journal de 20 heures à la diffusion via les canaux médiatiques des légendes urbaines (des histoires fausses a priori vraisemblables et possédant des variantes), il ne s’agit désormais que d’assurer le bon fonctionnement du théâtre de l’angoisse qui fascine les spectateurs. La télévision et l’Internet ne sont plus la forme moderne de l’œil divin mais les instruments de l’observation de tous par tous : en témoignent les émissions d’exposition de la vie privée (Cf. Loft puis Secret Story)
Par conséquent, l’information dite sérieuse utilise aujourd’hui les mêmes recettes de transformation de faits en légendes, à savoir l’amplification, le déplacement et la reconstruction. Légendes qui alimentent par la suite de nombreuses paniques (alimentaires, technologiques, etc.). Que penser au bout du compte ?… Faisons l’hypothèse que l’insécurité ne se confond pas avec le spectacle de l’insécurité… La première est une question liée à l’extension de la société de défiance, la seconde, un show business… Ce qui est certain, c’est que le spectacle de la peur contemporain altère considérablement les faits et biaise l’analyse.
Quels liens faites-vous entre la mort du storytelling du progrès, l’idéologie sécuritaire et la société de surveillance ? Dans le contexte du débat sur l'état d'urgence, certains commentateurs mettent en garde quant aux possibles dérives liberticides de l'action de l'État. Cette inquiétude est-elle légitime ?
La croyance au Progrès a sombré dans les ténèbres de l’histoire du XXe siècle. Deux guerres mondiales et la Shoah, les désillusions de la modernité, la mort des grands ou métarécits chers à Lyotard, entretiennent la dépression collective européenne : au début de ce troisième millénaire, elles l’alimentent encore et toujours. Il est d’ailleurs fort probable que l’on mobilise de nos jours autant le terme de « valeurs » parce que l’on ne dispose plus de grands récits d’explication et de transformation du monde. En tout état de cause, depuis la mort de l’humanisme, de la croyance en l’Homme, dans la première moitié du siècle dernier, les premières phrases du mythe de Sisyphe ne cessent pas de nous hanter : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. […] Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions ». Nous cherchons toujours des raisons de vivre depuis que beaucoup d’entre nous pensent que Dieu est mort et que l’humanité laisse à désirer…
Camus explique à la perfection le sentiment d’abandon qui nous étreint, l’incertitude qui nous ronge, la panique qui nous dévore, et pourquoi la mort peu sembler une solution, en tout état de cause une tentation…Il en dérive ce sentiment de l’absurde, qui décrit si bien notre temps depuis plusieurs décennies, et dont il se fit le porte-parole avant d’organiser une certaine forme de résistance au désespoir montant.
Mais nous voulons jouir de la vie : c’est humain. Alors la société du spectacle répond à nos attentes et s’allie à la surveillance de tous par tous, afin de nous aider à vaincre l’intériorité, pourtant constitutive de l’humanisme individualiste dont nous nous prétendons les héritiers. En réalité, tout conspire à nous rendre difficile l’effort de penser, par nous-mêmes et en-dehors des idéologies… Si nous y parvenions, nous serions en mesure de constater que l’apocalypse n’est pas pour demain, qu’hier n’était pas moins menaçant qu’aujourd’hui, mais qu’il était en revanche plus ordonné. Il dérive de notre manque de lucidité et de notre réticence à l’intelligence du monde que nous créons au quotidien une société de défiance. Nous craignions les démons que l’Autre porte en lui. Et nous créons ainsi des citadelles au lieu de diagnostiquer le mal, d’en discerner les chemins, et de combattre les mécanismes qui lui permettent de naître et de se reproduire.
Mécanique sociale dans tout cela, on peut le voir facilement… Il n’existe donc pas de complot du pouvoir, pas d’idéologie sécuritaire synonyme d’une tentation totalitaire des pouvoirs, de l’Etat. Pas davantage ne peut-on identifier un complot pour instaurer un régime de surveillance. Big Brother est introuvable… L’idéologie sécuritaire, c’est notre idée fixe, collective, de n’être jamais vulnérable, notre désir pathologique d’éviter tous les risques. C’est aussi notre manie de ne pas vouloir prendre en considération le réel, et de vivre dans nos fantasmes et dans des catégories abstraites. La société de surveillance, c’est notre appétit pour la transparence, notre guerre contre l’intime, notre chasse de l’individu qui veut préserver la frontière entre privé et public. Elle existe bel et bien, mais l’Etat contribue à la développer parce qu’il sent la demande sociale, pas parce que des « fascistes », des psychopathes et des idéologues totalitaires, souhaitent l’avènement d’un « homme nouveau ». A l’heure du totalitarisme soft, les citoyens ont eux-mêmes créé la société de surveillance (les réseaux sociaux ou la téléréalité en témoignent), l’entretiennent, et fabriquent l’idéologie sécuritaire, cristallisation de leurs peurs et de leur cécité intellectuelle.
Camus explique à la perfection le sentiment d’abandon qui nous étreint, l’incertitude qui nous ronge, la panique qui nous dévore, et pourquoi la mort peu sembler une solution, en tout état de cause une tentation…Il en dérive ce sentiment de l’absurde, qui décrit si bien notre temps depuis plusieurs décennies, et dont il se fit le porte-parole avant d’organiser une certaine forme de résistance au désespoir montant.
Mais nous voulons jouir de la vie : c’est humain. Alors la société du spectacle répond à nos attentes et s’allie à la surveillance de tous par tous, afin de nous aider à vaincre l’intériorité, pourtant constitutive de l’humanisme individualiste dont nous nous prétendons les héritiers. En réalité, tout conspire à nous rendre difficile l’effort de penser, par nous-mêmes et en-dehors des idéologies… Si nous y parvenions, nous serions en mesure de constater que l’apocalypse n’est pas pour demain, qu’hier n’était pas moins menaçant qu’aujourd’hui, mais qu’il était en revanche plus ordonné. Il dérive de notre manque de lucidité et de notre réticence à l’intelligence du monde que nous créons au quotidien une société de défiance. Nous craignions les démons que l’Autre porte en lui. Et nous créons ainsi des citadelles au lieu de diagnostiquer le mal, d’en discerner les chemins, et de combattre les mécanismes qui lui permettent de naître et de se reproduire.
Mécanique sociale dans tout cela, on peut le voir facilement… Il n’existe donc pas de complot du pouvoir, pas d’idéologie sécuritaire synonyme d’une tentation totalitaire des pouvoirs, de l’Etat. Pas davantage ne peut-on identifier un complot pour instaurer un régime de surveillance. Big Brother est introuvable… L’idéologie sécuritaire, c’est notre idée fixe, collective, de n’être jamais vulnérable, notre désir pathologique d’éviter tous les risques. C’est aussi notre manie de ne pas vouloir prendre en considération le réel, et de vivre dans nos fantasmes et dans des catégories abstraites. La société de surveillance, c’est notre appétit pour la transparence, notre guerre contre l’intime, notre chasse de l’individu qui veut préserver la frontière entre privé et public. Elle existe bel et bien, mais l’Etat contribue à la développer parce qu’il sent la demande sociale, pas parce que des « fascistes », des psychopathes et des idéologues totalitaires, souhaitent l’avènement d’un « homme nouveau ». A l’heure du totalitarisme soft, les citoyens ont eux-mêmes créé la société de surveillance (les réseaux sociaux ou la téléréalité en témoignent), l’entretiennent, et fabriquent l’idéologie sécuritaire, cristallisation de leurs peurs et de leur cécité intellectuelle.
Quelle est la marge de manœuvre de l'action politique face à l'avènement de la société de défiance ? Les hommes politiques ne jouent-ils pas sur ce climat pour servir leurs ambitions plutôt que de chercher à construire un contre modèle fondé sur la confiance ?

Nous vivons une ère étrange où la gestion se mêle à l’idéologie, sans autre résultat que l’immobilisme et l’échec. Chacun tend à prendre les choses comme elles sont et comme elles viennent, donnant l’impression d’apprendre à s’en contenter, tout en contestant plus ou moins mollement. Toutefois, c’est une atmosphère qui est directement liée à un sentiment d’impuissance du politique. Constat banal mais essentiel. D’autant plus que cette impuissance produit une situation extrêmement dangereuse, car l’absence d’affrontements idéologiques et d’action politique connexe laisse le champ libre à l’expression de la violence. L’idée que la chose publique se résume à des discussions de gestionnaires paralyse la politique. Depuis plus de vingt cinq ans, on a pris l’habitude de croire que l’on pouvait trouver des solutions techniques à tous les problèmes, en évitant tout arbitrage lié aux valeurs. L’Europe oublie ce qui fit l’essence même de notre matrice culturelle : la réflexion. Une réflexion qui ne constitua jamais le privilège exclusif de quelques philosophes dont on pourrait dresser la liste.
Il importe que les politiciens redeviennent des dirigeants politiques capables de réfléchir le monde et pas simplement de nous proposer de le « gérer ». Il convient de nouveau de désirer l’influencer. Il existe toujours des marges de manœuvre : encore faut-il bien vouloir tout mettre en œuvre pour les trouver. La politique n’a pas pour vocation d’avancer des propositions techniciennes mais d’indiquer des directions à l’administration, dont le rôle est de les décliner en un dispositif opérationnel cohérent. On ne peut pas gouverner en affichant comme projet phare la réduction des déficits sociaux et budgétaire : n’importe quelle équipe gouvernementale cherche désormais à les réduire. Il faut être conscient qu’un tel objectif (très loin d’un « grand dessein ») ne provoquera jamais l’enthousiasme des citoyens. Ces derniers finissent alors par penser que tous les décideurs classiques se valent, qu’il n’existe entre eux aucun clivage idéologique ou pratique significatifs, et que seules les extrêmes désignent un horizon à atteindre… A la racine de notre problème, on trouve incontestablement l’épuisement du clivage droite/gauche.
Il importe que les politiciens redeviennent des dirigeants politiques capables de réfléchir le monde et pas simplement de nous proposer de le « gérer ». Il convient de nouveau de désirer l’influencer. Il existe toujours des marges de manœuvre : encore faut-il bien vouloir tout mettre en œuvre pour les trouver. La politique n’a pas pour vocation d’avancer des propositions techniciennes mais d’indiquer des directions à l’administration, dont le rôle est de les décliner en un dispositif opérationnel cohérent. On ne peut pas gouverner en affichant comme projet phare la réduction des déficits sociaux et budgétaire : n’importe quelle équipe gouvernementale cherche désormais à les réduire. Il faut être conscient qu’un tel objectif (très loin d’un « grand dessein ») ne provoquera jamais l’enthousiasme des citoyens. Ces derniers finissent alors par penser que tous les décideurs classiques se valent, qu’il n’existe entre eux aucun clivage idéologique ou pratique significatifs, et que seules les extrêmes désignent un horizon à atteindre… A la racine de notre problème, on trouve incontestablement l’épuisement du clivage droite/gauche.
Pour quelles raisons le clivage idéologique droite/gauche est devenu obsolète? Quelles sont les conséquences à en tirer pour l'avenir de notre modèle démocratique?
Le clivage droite/gauche s’imposa comme le moteur de l’histoire politique de notre pays durant deux siècles. Son enrayement nous signale précisément que le Progrès est mort et traduit notre désir hystérique de sécurité. On peut aujourd’hui penser qu’il ne constitue plus la locomotive d’une sorte de progrès social. Il ne traduit plus des forces réelles en affrontement. L’exigence prométhéenne portée par la gauche révolutionnaire de 1789 ne trouve plus en la droite républicaine un adversaire mais une variante. C’est à l’intérieur du cadre philosophique de la modernité que se situe le combat partisan et que s’inscrit le débat et la confrontation politiques. La droite et la gauche ne s’opposent plus sur la légitimité de certaines valeurs mais sur la régulation à la marge d’un système qui nous semble échapper en très large partie à la maîtrise humaine.
Sur quoi peut se fonder aujourd’hui le clivage droite/gauche aujourd’hui ? Les enjeux originels ont disparu : la question de la forme du régime (monarchie vs république), la question du religieuse (séparation de l’Eglise et de l’Etat), et la question sociale (partisans de la propriété publique contre ceux de la propriété privée). Toutes trois concernaient des oppositions fondamentales sur le cadre a priori de l’existence collective. Ces trois confrontations, déployées entre 1789 et 1989, définissaient à la fois une syntaxe et une philosophie de droite et une autre de gauche (précédemment explorées). Elles ne font plus sens de nos jours parce que l’échiquier sur lequel se déroulent les mouvements des pièces politiques résulte de la victoire philosophique, psychologique et culturelle de la gauche mythique républicaine agrémentée de social-démocratie (où voisinent l’ombre de Jaurès et de Keynes plutôt que celle de Marx, eu égard à l’échec de l’expérience communiste signifiée par l’effondrement du monde soviétique).
La survie artificielle de la césure droite/gauche ne fait que visibiliser davantage la similarité des conduites gouvernementales malgré les affichages partisans. Le combat politicien tourne à vide. Ce sont davantage des « écuries » qui s’affrontent que des programmes et des idéologies. Les réformes sociétales voulues par les partis dits de gauche ne suffisent pas à s’imposer en marqueuses d’identité. Il suffit d’ailleurs de constater que ces débats de société produisent des fractures au sein même des partis. Ils ne peuvent en aucun cas polariser les identités politiques. Nul projet global ne les anime et ne peut prétendre à former un métarécit susceptible de justifier une dialectique conflictuelle constructive dans l’arène parlementaire. La construction européenne et l’écologie ne fondent pas davantage une bipolarisation crédible de la vie politique. Les débats existants ou possibles n’opposent pas des partisans de l’Union à des adversaires de l’Europe. Faut-il en venir à distinguer les partisans de l’Etat communautaire à ceux de l’Etat nation ? Peut-être… Encore faudrait-il creuser ce que cela signifie vraiment, en profondeur… Des surprises seraient sans doute au rendez-vous.
Il est donc temps de réfléchir à nos désaccords, et non plus de dissimuler nos convergences. Ceci afin de mieux nous rassembler, sans nier nos particularités, qui pourraient devenir des complémentarités, enfin…
Sur quoi peut se fonder aujourd’hui le clivage droite/gauche aujourd’hui ? Les enjeux originels ont disparu : la question de la forme du régime (monarchie vs république), la question du religieuse (séparation de l’Eglise et de l’Etat), et la question sociale (partisans de la propriété publique contre ceux de la propriété privée). Toutes trois concernaient des oppositions fondamentales sur le cadre a priori de l’existence collective. Ces trois confrontations, déployées entre 1789 et 1989, définissaient à la fois une syntaxe et une philosophie de droite et une autre de gauche (précédemment explorées). Elles ne font plus sens de nos jours parce que l’échiquier sur lequel se déroulent les mouvements des pièces politiques résulte de la victoire philosophique, psychologique et culturelle de la gauche mythique républicaine agrémentée de social-démocratie (où voisinent l’ombre de Jaurès et de Keynes plutôt que celle de Marx, eu égard à l’échec de l’expérience communiste signifiée par l’effondrement du monde soviétique).
La survie artificielle de la césure droite/gauche ne fait que visibiliser davantage la similarité des conduites gouvernementales malgré les affichages partisans. Le combat politicien tourne à vide. Ce sont davantage des « écuries » qui s’affrontent que des programmes et des idéologies. Les réformes sociétales voulues par les partis dits de gauche ne suffisent pas à s’imposer en marqueuses d’identité. Il suffit d’ailleurs de constater que ces débats de société produisent des fractures au sein même des partis. Ils ne peuvent en aucun cas polariser les identités politiques. Nul projet global ne les anime et ne peut prétendre à former un métarécit susceptible de justifier une dialectique conflictuelle constructive dans l’arène parlementaire. La construction européenne et l’écologie ne fondent pas davantage une bipolarisation crédible de la vie politique. Les débats existants ou possibles n’opposent pas des partisans de l’Union à des adversaires de l’Europe. Faut-il en venir à distinguer les partisans de l’Etat communautaire à ceux de l’Etat nation ? Peut-être… Encore faudrait-il creuser ce que cela signifie vraiment, en profondeur… Des surprises seraient sans doute au rendez-vous.
Il est donc temps de réfléchir à nos désaccords, et non plus de dissimuler nos convergences. Ceci afin de mieux nous rassembler, sans nier nos particularités, qui pourraient devenir des complémentarités, enfin…



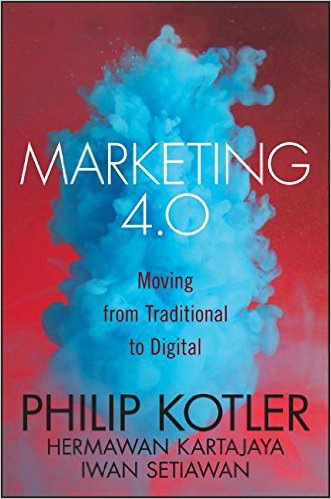
 Proposer une chronique Magazine
Proposer une chronique Magazine